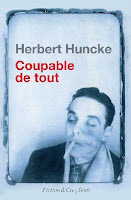« Nuage rouge », comme on le surnomme, Serge Venturini n’est pas un brasier de colère, mais un éveilleur de lucide conscience. Ses traductions d‘Alexandre Blok, d’Anna Akhmatova, de Sayat-Nova et d’autres, ses hommages à Missak Manouchian, renseignent sur son empathie pour « la poétique de résistance », vers ceux qui se tiennent debout à l’orée des mots.
Mots d’éclairs destinés à consumer tous les hommes de paille squattant l’humanité.
Serge Venturini est un poète français, né le 12 octobre 1955 à Paris.
C'est un poète du devenir humain. Il écrit dans le devenir de la
poésie. Sa poétique est traversée par de nombreuses métamorphoses : Poétique du devenir humain (2000), Poétique du posthumain (2007), Poétique du transhumain (2009), au Journal du transvisible (2010), de la Poétique de l'inaccompli (2012) à la Poétique de l'approche de l'inconnaissable, (2010-2013).
Sa poésie philosophique est en lutte contre les conformismes, elle
cherche l'éclatement des genres et n'éclaire que par renversements.
Serge Venturini dirige depuis 2009, la collection « Lettres arméniennes » aux Éditions L'Harmattan. Sa poésie engagée est celle d'un « itinérant avec la brûlante et dense vérité de sa parole en actes. »
Entre le visible et l'invisible, le réel et le rêve, le transvisible se situe à l'intersection de ces mondes, des mondes, où il joue l'interface. Insistons sur leur perméabilité, la porosité de ces mondes, car certains esprits trop cartésiens sont étrangers à ce dialogue. Les poètes mythographes, vecteurs de transvisibilité, passeurs de lumière, porteurs du feu de la parole, sont des êtres à mi-chemin entre ces deux mondes. Dans le passage du visible à l'invisible, du monde des vivants au monde des morts, le transvisible transfigure le temps.
Gil Pressnitzer
TIGRE DE L’ŒIL
J’étais de ce grand corps, l’âme toute-puissante.
Jean Racine, « Britannicus », I, 1, Agrippine, 1669
Or, nous cheminons hennissant tel Pégase vers le transvisible. Les êtres visibles me sont souvent invisibles, alors que je vois, dans mes absences au monde réel, — les êtres invisibles.
Lorsque mon regard transperce l’invisible, ils me sont manifestes dans la transparence, ils viennent sourdre du visible pour apparaître, tout droit venus de l’invisible couverts de cette rosée comme surgis d’une brume épaisse, connus et inconnus.
Le beau, et cela n’est guère neuf, est l’expression de l’invisible, même si le mystère de ce monde demeure dans le visible, même si les temps où nous vivons refusent de regarder en face l’invisible, car ils refusent de sortir de la matière pour voir au-delà du corps. Chez eux, — l’œil n’écoute plus rien, n’entend plus ni langues rares, ni couleurs stridentes, ni parfums empourprés.
Quand la porte du visible est enfin ouverte, alors dans toute sa splendeur les formes éclatantes émergent de l’invisible. Les corps animés deviennent musique, théâtre d’ombres portées au plus noir, — têtes renversées.
Cependant nous ne sommes plus dans le monde des fantômes, dans le monde des fausses apparences, nous sommes dans le monde de l’être, — du devenir même aux formes changeantes et scintillantes, où nous apercevons l’espace-temps d’un instant, le déploiement de ces beautés neigeuses d’éclat qui toujours nous subjuguent. — Ô Fravarti !
Elles vont ces corps-dansant, ces corps fluides, ces corps liquides se développant aux rayons du soleil naissant, corps brûlants entrevus, à la flamme d’une chandelle, au clair-obscur du désir, comme au plus profond de la nuit miroitante.
Dans un mythe qui n’a pas encore dit son nom, étoile non-visible à l’œil nu, — ma présence dévoilée se révèle dès lors dans l’invisible. — Non ! Je ne suis pas hors du grand corps,
— mais en plein cœur de la vision.
Paris, le 22 décembre 2007